Voici quelques documents concernant la relation entre René Lévesque et Daniel Johnson
Daniel Johnson
 Daniel Johnson (1915-1968), avocat, député, ministre, chef de l’Union nationale, chef de l’opposition officielle, premier ministre du Québec. Il naît à Danville dans la région québécoise de l’Estrie. Sa mère Marie-Adéline Daniel, décède en 1936 de la tuberculose. Son père, Francis Johnson, est journalier.
Daniel Johnson (1915-1968), avocat, député, ministre, chef de l’Union nationale, chef de l’opposition officielle, premier ministre du Québec. Il naît à Danville dans la région québécoise de l’Estrie. Sa mère Marie-Adéline Daniel, décède en 1936 de la tuberculose. Son père, Francis Johnson, est journalier.
Bien qu’issus d’un milieu modeste, Daniel et ses trois frères font de brillantes études supérieures. Réginald fera une carrière de cardiologue, Maurice sera juge et Jacques professeur de sociologie. Daniel lui hésite entre la prêtrise et le droit, mais choisit finalement cette dernière vocation. Il fait donc ses études de droit à l’Université de Montréal (1937-1940) après ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe (1928-1935) et ses études primaires chez les Frères du Sacré-Cœur de Danville (1922-1928). Il prend une part active dans la vie étudiante : il écrit dans Le Quartier Latin 1, préside l’Association générale des étudiants de l’Université de Montréal et la Fédération canadienne des étudiants catholiques.
Il est admis au Barreau du Québec le 20 juillet 1940 et exerce son métier à partir de Montréal avec différents associés. Durant sa carrière, il agit à titre de conseiller juridique auprès de plusieurs associations et syndicats : le Conseil central de Montréal, la Confédération des travailleurs catholiques du Canada, l’Association des hôteliers du Québec, la Chambre de commerce des jeunes du Québec et du Canada, etc.
Daniel Johnson a 28 ans lorsqu’il épouse Reine Gagné (1919-1994), le 2 octobre 1943, dans la paroisse Notre-Dame-de-Grâce de Montréal. Le couple aura quatre enfants : Daniel, Pierre Marc, Diane et Marie.
Égalité ou indépendance
C’est dans la deuxième moitié des années 1940, peu après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qu’il fait le saut en politique. À sept reprises, de 1946 à 1966, les électeurs et les électrices de la circonscription de Bagot l’élisent député de l’Assemblée législative du Québec sous la bannière de l’Union nationale. Pendant quelque dix ans, il est un parlementaire loyal au chef de l’Union nationale, Maurice Duplessis. Sa loyauté est récompensée en 1955 par un poste d’adjoint parlementaire au président du Conseil exécutif et trois ans plus tard, en 1958, par l’octroi du portefeuille du ministère des Ressources hydrauliques.
Le décès du premier ministre Maurice Duplessis en 1959, suivi rapidement du décès de son successeur Paul Sauvé en 1960, conduisent Antonio Barrette, député de Joliette et ministre du Travail, au poste de premier ministre du Québec et à celui de chef de l’Union nationale. Quelque six mois plus tard, à l’été 1960, l’Union nationale de Barrette est éjectée du pouvoir à Québec lors d’élections générales aujourd’hui mythiques qui favorisent les libéraux de Jean Lesage. Tout comme son chef Antonio Barrette, Daniel Johnson conserve son siège de député et se retrouve dans l’opposition. Cependant, quelques mois plus tard, en septembre 1960, Antonio Barrette démissionne comme député et comme chef de l’Union nationale.
Un an plus tard, en septembre 1961, Daniel Johnson remporte la course à la direction de son parti contre Jean-Jaques Bertrand, député de Missisquoi, qui a été plusieurs fois ministre dans les cabinets de Duplessis, Sauvé et Barrette. Même s’il est défait lors de l’élection référendaire de 1962 sur la nationalisation de l’électricité au Québec, il reste en poste et, après quelques années dans l’opposition, parvient à s’emparer du pouvoir provincial lors des élections générales de l’été 1966.
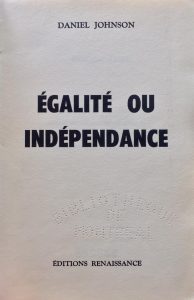 Un peu plus d’un an auparavant, en mars 1965, il publiait le livre Égalité ou indépendance, qui synthétise la position de l’Union nationale sur les questions constitutionnelles, en particulier celle du statut politique de l’État du Québec, fédéré au sein du Canada depuis 1867. Daniel Johnson et son parti reconnaissent qu’il existe au Canada deux nations, au sens sociologique du terme, qui se distinguent par leur langue et leur culture, et qui doivent être égales «en droit et en fait» dans la constitution politique de l’État fédéral canadien. Dans le contexte de la décolonisation de l’après-Deuxième Guerre mondiale, l’autodétermination des peuples est un principe fortement affirmé sur la scène internationale et les Québécois doivent être libres de s’épanouir pleinement dans le cadre canadien ou hors de celui-ci si nécessaire. C’est l’inauguration de la stratégie constitutionnelle 2 qui utilise la menace de l’indépendance du Québec comme arme de négociation face au Canada anglophone.
Un peu plus d’un an auparavant, en mars 1965, il publiait le livre Égalité ou indépendance, qui synthétise la position de l’Union nationale sur les questions constitutionnelles, en particulier celle du statut politique de l’État du Québec, fédéré au sein du Canada depuis 1867. Daniel Johnson et son parti reconnaissent qu’il existe au Canada deux nations, au sens sociologique du terme, qui se distinguent par leur langue et leur culture, et qui doivent être égales «en droit et en fait» dans la constitution politique de l’État fédéral canadien. Dans le contexte de la décolonisation de l’après-Deuxième Guerre mondiale, l’autodétermination des peuples est un principe fortement affirmé sur la scène internationale et les Québécois doivent être libres de s’épanouir pleinement dans le cadre canadien ou hors de celui-ci si nécessaire. C’est l’inauguration de la stratégie constitutionnelle 2 qui utilise la menace de l’indépendance du Québec comme arme de négociation face au Canada anglophone.
Rapport de force
 En 1967, Daniel Johnson invite le président Charles de Gaulle à visiter Expo 67, l’Exposition universelle qui se tient à Montréal à l’initiative du maire Jean Drapeau, et qui coïncide avec le centenaire de la fédération canadienne et la montée, au Québec, du mouvement indépendantiste contemporain. S’il n’a certainement pas prévu que le général de Gaulle irait aussi loin dans ses déclarations publiques de juillet 1967, en particulier le célèbre discours de l’hôtel de ville de Montréal, Johnson ne pouvait qu’en tirer bénéfice politiquement, lui qui cherchait à établir un rapport de force avec le Canada pour provoquer une importante réforme constitutionnelle.
En 1967, Daniel Johnson invite le président Charles de Gaulle à visiter Expo 67, l’Exposition universelle qui se tient à Montréal à l’initiative du maire Jean Drapeau, et qui coïncide avec le centenaire de la fédération canadienne et la montée, au Québec, du mouvement indépendantiste contemporain. S’il n’a certainement pas prévu que le général de Gaulle irait aussi loin dans ses déclarations publiques de juillet 1967, en particulier le célèbre discours de l’hôtel de ville de Montréal, Johnson ne pouvait qu’en tirer bénéfice politiquement, lui qui cherchait à établir un rapport de force avec le Canada pour provoquer une importante réforme constitutionnelle.
On peut se faire une idée de la vision du Canada de demain qu’avait alors le Québec en lisant l’allocution d’ouverture du premier ministre Daniel Johnson à la conférence constitutionnelle de novembre 1967 3. On trouve une analyse plus détaillée de cette vision dans la section consacrée au gouvernement de Daniel Johnson père du document officiel 4 intitulé Positions du Québec dans les domaines constitutionnel et intergouvernemental de 1936 à mars 2001.
Daniel Johnson meurt en fonction le 26 septembre 1968, à l’âge de 53 ans, alors qu’il se trouve au barrage hydroélectrique Manic-5 sur le point d’être inauguré. Il est décédé d’une crise cardiaque au cours de la nuit. Le barrage, qui devait être nommé « barrage Duplessis », sera finalement nommé «barrage Daniel-Johnson» en 1969.
Sa mort inattendue sème la consternation parmi la population et une théorie du complot, qui évoque un assassinat par empoisonnement afin de stopper celui qu s’apprêtait à réaliser l’indépendance du Québec, trouve des adeptes encore aujourd’hui.
Daniel ne sera pas le dernier Johnson à marquer l’histoire politique québécoise et canadienne : son fils Pierre Marc, du Parti québécois, sera comme lui premier ministre du Québec en 1985, et son autre fils, Daniel, du Parti libéral du Québec, le sera également en 1994.
Domaine public
Daniel Johnson a signé plusieurs articles parus notamment dans Le Quartier Latin et La Patrie. Plusieurs de ses allocutions et discours politiques sont publiés. Comme auteur, il est surtout associé à l’essai intitulé Égalité ou indépendance 5 (Montréal, 1965 et Paris, 1968).
Sources et références
Ouvrages
- Benoît Gignac, Le destin Johnson : une famille, trois premiers ministres (Stanké, 2007)
- Jean Loiselle, Daniel Johnson : le Québec d’abord (VLB, 1999)
- Robert Comeau et al. (dir.), Daniel Johnson : rêve d’égalité et projet d’indépendance (PUQ, 1991)
- Albert Gervais, Daniel Johnson (Lidec, 1984)
- Pierre Godin, Daniel Johnson (De l’Homme, 1980)
- Paul Gros d’Aillon, Daniel Johnson : l’égalité avant l’indépendance (Stanké, 1979)
- Jean-Louis Laporte, Daniel Johnson, cet inconnu (Beauchemin, 1968)
Articles
- S. A., « Daniel Johnson (père) (1915-1968) », site de l’Assemblée nationale du Québec, avril 2009.
- Claude Bélanger, « Daniel Johnson », Quebec History, Marianopolis College, 2003.
- Collectif, « Daniel Johnson (père) », Wikipédia, consulté le 16 décembre 2018.
- S. A., « Daniel Johnson (1915-1968) Homme politique », Bilan du siècle, Université de Sherbrooke.
- Jean-François Nadeau, « Daniel Johnson, ni l’égalité ni l’indépendance », Le Devoir, 26 septembre 2018.
- Daniel Latouche, « Daniel Johnson (père) », L’Encyclopédie canadienne / The Canadian Encyclopedia, 18 février 2008 (màj le 1er avril 2015 par Nicolas Harvey).
- Le Courrier, « 50e anniversaire du décès de Daniel Johnson. Des funérailles mémorables à Saint-Pie », Le Courrier de Saint-Hyacinthe, 27 septembre 2018.
- Pierre Godin, « Daniel Johnson ou l’ambivalence québécoise », Cap-aux-Diamants, numéro 35, automne 1993, p. 50–53.
- Éric Bélanger, « “Égalité ou indépendance”. L’émergence de la menace de l’indépendance politique comme stratégie constitutionnelle du Québec », Globe. Revue internationale d’études québécoises, volume 2, numéro 1, 1999, p. 117–138.
Audiovisuel
- Éric Bédard (invité) et Jacques Beauchamp (animateur), « Daniel Johnson, un politicien au destin inachevé », à l’émission de radio Aujourd’hui l’histoire, Radio-Canada, 23 mai 2016.
- Jean-Claude Marion, Le député de Bagot : Daniel Johnson, Montréal, Ciné Fête, 2002, 48 min.
- John Kramer, Les Johnson, ONF, 1980, 58 min.
- « Les dernières heures de Daniel Johnson avant sa mort », Radio-Canada Première, 25 septembre 1968, 9 min.
- « Le débat Daniel Johnson – Jean Lesage », Les Archives de Radio-Canada, 12 novembre 2008, 15 min. (extrait de l’émission de télé diffusée à Radio-Canada, le 11 novembre 1962.)
Notes et liens complémentaires
- Le Quartier Latin (BAnQ).
- Éric Bélanger. « Égalité ou indépendance ». L’émergence de la menace de l’indépendance politique comme stratégie constitutionnelle du Québec. Revue Globe, Volume 2, Numéro 1, 1999.
- Allocution d’ouverture du premier ministre du Québec, M. Daniel Johnson, à la Conférence sur la “Confédération de demain”, Toronto, lundi le 27 novembre 1967. BAnQ numérique.
- Positions du Québec dans les domaines constitutionnel et intergouvernemental de 1936 à mars 2001. Secrétariat du Québec aux relations canadiennes. Téléchargement (PDF, 306 Ko).
- Voir Égalité ou indépendance. La Bibliothèque indépendantiste.
Illustration
- Buste de Daniel Johnson (père). Bronze réalisé par Paul Lancz. Photo: Jean Gagnon (2012). Licence: Creative Commons BY-SA.
- Cérémonie d'ouverture de l'Expo 67. De gauche à droite: Lester B. Pearson, premier ministre du Canada; Roland Michener, gouverneur-général; Daniel Johnson, premier ministre du Québec; Jean Drapeau, maire de Montréal. Bibliothèque et Archives Canada (domaine public).
GUY Huard 14 nov. 2023
En fouillant un peu, j'ai retrouvé cet article publié en 2013 par Erhet basé sur un premier publié par Raynald Rouleau en 2002 dans L'Acropole. GH
Tout compte fait, Daniel Johnson aura été le dernier des ambivalents. Sans doute l'indécision aura-t-elle été sa marque de commerce, à l'opposé d'un René Lévesque, avocat déclaré de la souveraineté du Québec, ou d'un Robert Bourassa, ténor tout aussi inconditionnel mais du fédéralisme canadien.
En fait, pour ce qui concerne Johnson, ne serait-il pas plus approprié de parler de stratégie fine, de la pratique d'une dialectique entre deux volontés ? Tout en restant déterminé quant aux objectifs énoncés, ceux-ci étaient le reflet authentique de nos revendications historiques. Johnson n'avait donc rien de l'idéologue. Pas étonnant qu'on trouve si peu chez lui les appels au renversement de la monarchie ou de l'instauration d'une république. Il avait compris que le braquage et les négociations conflictuelles, tout ce qui pouvait ressembler à un ultimatum pour résoudre le contentieux constitutionnel serait stérile.
L'approche référendaire s'y essaiera. Gonflée, elle voudra mettre le Canada devant un fait accompli avant de négocier. C'était courir au désastre. L'assurance nouvelle, issue des acquis économiques de la Révolution tranquille, ne pouvait être transposée sur le plan de notre statut au sein de la Confédération. Nous étions toujours un peuple conquis, ne disposant d'aucune reconnaissance constitutionnelle claire, de surcroit, fondait notre poids démographique au sein du Canada. Pouvait-on ignorer la nature aussi délicate d'un rapport de force qui pouvait tourner en notre défaveur. Défier ouvertement le Canada sans s'y ménager quelques bons sentiments, éventuellement certains appuis, pouvait nous coûter une lente montée en puissance retrouvée graduellement après la défaite de 1837-38. Il est bon de s'en souvenir, ce n'est pas pour rien que l'approche référendaire avait été suggérée à Claude Morin par des proches de Trudeau et ce, à plusieurs occasions. Je pense que Pierre Godin fait une analyse entachée de partisannerie quand il oppose Johnson à Lévesque de cette façon :
« Sans doute l'indécision [de Johnson] aura-t-elle été sa marque de commerce, à l'opposé d'un René Lévesque, avocat déclaré de la souveraineté du Québec... »
Godin, biographe quelque peu complaisant, raconte l'histoire à l'envers. Lévesque soufflait alternativement le chaud et le froid, laissait croire qu'il avançait, mais reculait en réalité quand le rapport de force aurait voulu qu'il en remette. Il aura été le vrai personnificateur de l'indécision et de l'ambigüité. Petit à petit il se prendra lui-même dans une souricière, reprochant tantôt à Trudeau et aux provinces de ne pas avoir joué franc jeu ou au peuple de ne pas avoir suivi.
Godin semble gravement sous-estimer qu'avec Johnson, l'égalité pour les Canadiens-Français et les Acadiens était une position de principe non négociable, Certes, la formule pour en arriver là devait l'être, et il avait raison de ne pas dissimuler sa bonne foi. Ce n'était pas de l'ambiguïté mais de la maturité.
C'est en février 1968 que s'est joué l'épisode le plus dramatique de notre histoire contemporaine. Elle aura des conséquences qui n'ont pas encore cessé de percoler négativement sur notre peuple. Au lieu de former une alliance des Canadiens-Français en vue de tirer le meilleur parti d'une conjoncture relativement avantageuse (1) pour l'avancement de notre peuple, c'est la division la plus mal avisée qui s'installa. Honoré Mercier avait écrit : « Cessons nos luttes fratricides », mais Lévesque, par pur esprit de clocher, qu'on appelle aussi la partisanerie politique, tomba à bras raccourcis sur les propositions constitutionnelles de Johnson.
Faites à Ottawa le 5 février 1968, ces propositions inédites seront dénoncées sept jours plus tard dans un article du Devoir. L'article fait état d'un communiqué du Mouvement souveraineté association, précurseur du Parti québécois. Lévesque y manifeste une volonté de conquérir à lui tout seul tout ce qu'il y avait de "nationalistes" au Québec. Après l'avoir fait, pour le reste de sa carrière, jamais Lévesque n'arrivera à présenter ses propres positions à Ottawa. En 1980, il n'y avait plus rien au menu, l'assiette bien garnie de Johnson, servie 12 ans plus tôt à ses vis-à-vis était vide, il n'y avait plus rien à négocier (2) sauf sauver un certain honneur, ce à quoi Lévesque échouera.
Si seulement Lévesque avait eu le même sens de l'intérêt national dont avait fait montre Jacques Parizeau au lendemain de l'échec des Accords du lac Meech, qui parlera de Robert Bourassa comme de son premier ministre, l'avenir de la nation en aurait pu être changé. Mais Lévesque avait d'autres plans : se séparer des Canadiens-Français et des Acadiens, pour rapatrier la "lutte nationale" au sein du Québec seulement et la désigner comme le combat d'une entité nationale nouvelle, composée de tous les habitants du Québec, appelant par référendum les Canadiens-Français et les Canadiens anglais à faire abstraction de leur identité nationale au profit d'une nation québécoise fictive, volontariste, issue de textes étatiques ou partisans.
On se demande parfois qui a été le plus grand premier ministre du QUébec ? On mentionne Duplessis, Johnson, Lévesque. À mon sens, pour avoir porté la lutte constitutionnelle plus loin que quiconque, Johnson remporte largemet la palme. Les gains constitutionnels réclamés par Johnson correspondaient pour nous à l'égalité des deux nations, c'était tout ce qu'on pouvait espérer et suffisant pour nous assurer un avenir dans la dignité.




Une réponse
René Lévesque répond à Daniel Johnson dans Le Devoir du 12 février 1968. La partisanerie à son meilleur. https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2777161